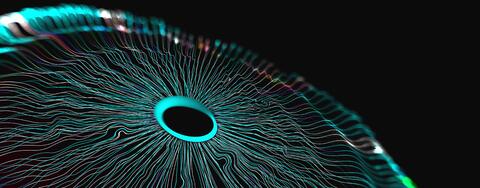
Voir avec les sons
Redonner la vue à des personnes aveugles grâce à une thérapie qui associe génétique et ultrasons, c'est l’espoir que nourrissent l’équipe de Serge Picaud, directeur de l’Institut de la Vision*, et le laboratoire Physique pour la médecine de l’ESPCI** en partenariat avec l’Institut d’ophtalmologie moléculaire et clinique de Bâle.

Maître de conférences de Sorbonne Université rattaché à l’Institut de la vision, Gregory Gauvain a participé au développement de cette thérapie sonogénétique qui consiste à activer à distance par ultrasons et de façon sélective, certains neurones modifiés génétiquement. Il nous explique en quoi cette nouvelle interface cerveau-machine, testée chez l’animal, représente une innovation majeure et un espoir thérapeutique pour les personnes atteintes d’atrophie du nerf optique.
En quoi la sonogénétique est une innovation majeure pour les personnes aveugles, notamment par rapport aux dernières avancées en optogénétique ?
Gregory Gauvain : Contrairement à la thérapie optogénétique qui visait la restauration visuelle au niveau de la rétine, la thérapie sonogénétique a l’avantage d’agir directement au niveau du cortex visuel. Elle permettrait donc, en théorie, d’apporter une solution pour redonner la vue aux patients qui ont perdu la connexion entre leurs yeux et leur cortex visuel en raison de pathologies comme le glaucome, la rétinopathie diabétique, ou les neuropathies optiques héréditaires ou alimentaires.
Comment fonctionne-t-elle ?
G.C. : La thérapie sonogénétique consiste à modifier génétiquement certains neurones afin de pouvoir les activer à distance par des ultrasons. Grâce à des vecteurs de thérapie génique, nous introduisons, dans les cellules du cortex visuel d’un rongeur, le code génétique d’un canal membranaire sensible à certaines fréquences d’ultrasons. Seuls les neurones de la zone traitée qui expriment ce canal peuvent alors être activés à distance par des ultrasons de faible intensité appliqués à la surface du cerveau.
Qu’avez-vous démontré dans l’étude publiée dans Nature Nanotechnology ?
G.C. : Nous avons apporté la preuve de concept de la thérapie sonogénétique sur les neurones de la rétine et le cortex visuel chez l’animal. Pour tester son efficacité, nous avons fait apprendre à des rongeurs en restriction hydrique un comportement associatif entre un flash lumineux et l’arrivée d’une goutte d'eau. Puis, nous avons remplacé la stimulation visuelle (le flash lumineux) par une stimulation sonogénétique dans leur cortex visuel. Nous avons alors observé le même comportement réflexe, ce qui suggère que la stimulation sonogénétique de son cortex visuel a bien induit la perception lumineuse à l’origine du réflexe comportemental.
Si l’on convertit les images de notre environnement sous forme d’ondes ultrasonores codées pour stimuler directement le cortex visuel, à des cadences de plusieurs dizaines d’images seconde, cette thérapie serait un espoir pour restaurer la vue des patients ayant perdu la fonction du nerf optique.
C’est un travail pluridisciplinaire entre l’institut de la vision et l’ESPCI. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette collaboration ?
G.C. : La collaboration avec l’équipe de Michaël Tanter nous a permis d’accélérer énormément le projet. Spécialiste des ondes en médecine, l’équipe développe actuellement un système d’imagerie ultrasonore fonctionnelle qui permettra d’obtenir une représentation visuelle de l'activité cérébrale qu'on induit par la stimulation sonogénétique. Une avancée majeure pour le développement de la thérapie sonogénétique et plus largement pour d’autres innovations neuroscientifiques.
Quelles étapes reste-t-il encore à franchir pour pouvoir envisager un essai clinique chez l’humain ?
G.C. : Le développement d’un essai clinique demande encore de nombreuses étapes pour valider l’efficacité et la sécurité de cette thérapie. Parmi elles, nous devrons d’abord prouver que la stimulation sonogénétique génère bien une perception visuelle. Pour cela, il nous faudra montrer - et nous y travaillons déjà - que l’animal discrimine deux formes avec deux stimulations différentes.
Nous devrons également vérifier, sur des modèles animaux plus complexes et plus proches de l’humain, que nous sommes capables de stimuler le cerveau en profondeur et sur des zones spécifiques, avec une bonne résolution spatiale.
Parallèlement, il faudra voir comment créer des patterns de stimulation en fonction de chaque patient et pouvoir adapter la simulation en temps réel en fonction de l’activité mesurée. Le système d’imagerie ultrasonore fonctionnelle développé par l’équipe de Michaël Tanter nous sera précieux.
Enfin, nous devrons, pour le transfert clinique, étudier, avec des partenaires industriels, comment ces stratégies évoluent dans le temps et nous assurer de l’innocuité de la thérapie.
*Sorbonne Université/Inserm/CNRS
**ESPCI Paris/PSL Université/Inserm/CNRS
